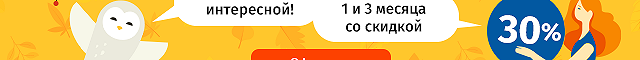
CCCLXXXII
AU MÊME
Nohant, 27 novembre 1854.
Mon ami,
Vous êtes bon; oui, bon! ce qui est être grand plus que ceux qui ne sont que grands. Je vous ai presque grondé, et vous me répondez, avec la douceur d'un enfant, que j'ai eu raison. Il n'y a qu'une seule chose, qu'un seul point, où je puisse avoir la raison absolue pour moi. C'est quand je m'afflige et me désole de ne pas vous voir. Je ne vous écris pas aujourd'hui: mon Maurice vient d'être non dangereusement, mais assez cruellement malade. Il va bien; mais, moi, je suis lasse, lasse, et je me trouve dans un arriéré de travail effrayant.
Où que vous soyez, écrivez-moi quelquefois. À présent que vous êtes un peu plus à vous-même qu'en prison, causons de loin; mais, au moins, causons de temps en temps.
Où que vous soyez, après avoir repris à la vie physique, dont vous devez avoir besoin sans vous en rendre compte, lisez et écrivez. Vous avez de bonnes choses à nous dire, même en dehors de ce vain monde des faits. Votre âme a monté plus haut que les nôtres, et ces romans que vous avez faits, entre ciel et terre dans les rêveries de la prison, vous nous les devez.
Adieu, pour cette nuit de fatigue. Je suis à vous de coeur et d'esprit.
G. SAND.
30 novembre. Emile, occupé pour Maurice d'une copie assez longue, ne m'a remis que ce soir la lettre que j'attendais pour vous envoyer la mienne. Je me vois donc quelques instants de calme pour vous redire que je pense à vous souvent; oui, bien souvent! Dans toutes les émotions, chagrin ou contentement, réflexion ou lecture, chaque fois que mon âme travaille, languit ou s'élève, je me compose un ciel, c'est-à-dire, selon Jean Reynaud, une terre, un monde, où j'espère aller, et tout de suite j'y appelle ceux de ce monde-ci que je veux et compte y retrouver. Et puis, dans les épreuves véritables, je pense aussi aux devoirs de cette vie où nous sommes, et votre patience, votre vertu (pardonnez-moi un mot vieilli, mais toujours bon), se présentent devant moi pour me donner de la volonté. Vous avez été bien malheureux, mon ami, et, pourtant, il me semble qu'au fond du coeur vous êtes le plus heureux des hommes, parce que vous avez la conscience la plus pure et l'équilibre le plus divin. Vous avez la certitude d'une récompense là-haut, tandis que, nous autres, nous n'avons que l'espoir d'un dédommagement.
Je vous demande pardon pour la lettre prolixe d'Émile. Il est prolixe, c'est sa nature, en écrivant. Il ne vous entretient que de nos malades, comme si c'était bien intéressant. Il ne se dit pas assez que vous recevez trop de lettres et que vous y répondez trop fidèlement.—La seule chose bonne de sa lettre, c'est la conversion qu'il vous doit, et dont il n'est pas encore bien rempli; car il ne me l'a fait savoir qu'en me permettant de lire l'aveu qu'il en fait. Nous avions des querelles sur ce sujet, et il en avait surtout avec Maurice, qui brûlait d'aller là-bas, et qui y aurait été, sans la crainte de mon désespoir en dedans. Je ne l'aurais pourtant pas empêché de suivre son idée, qui était à la fois artistique et patriotique. Mais j'aurais bien souffert!—Voilà que je fais comme Émile, et que je vous entretiens de nous. Rien de tout cela ne vaut la peine d'être dit.
Quand c'est à vous que je parle, je voudrais n'avoir à vous entretenir que de choses divines. J'en ai pourtant l'esprit tout plein, et je veux, un jour ou l'autre, faire un livre là-dessus que je vous dédierai. Je travaille comme un nègre pour de l'argent; il en faut pour les autres. Mais ce devoir-là est bien lourd! Quand donc, mon Dieu, aurai-je un an à moi, pour faire un livre qui ne me rapportera rien?
Encore adieu. Maurice, bien portant, vous embrasse, et vous déclare qu'il n'a pas eu la gale, mais tout bonnement une urticaire.
CCCLXXXIII
A M. CHARLES JACQUE, A BARBIZON
Nohant, 7 janvier 1855.
Ils et elles sont arrivés ce soir bien vivants, et je ne peux pas vous dépeindre la scène d'étonnement et d'admiration de toute la famille, bêtes et autres, à la vue de ces superbes animaux.
Quand tout cela ne donnerait ni oeufs ni poulets, c'est tellement beau à voir, qu'on se le payerait encore avec plaisir. On a tout de suite installé la compagnie dans son domicile et mis à l'engrais toute la valetaille, indigne de frayer avec pareille seigneurie. Vos instructions vont être affichées à toutes les portes de l'établissement, et j'aurai le plaisir d'y veiller; car ce monde-là en vaut la peine.
Que de remerciements je vous dois, monsieur, pour tant de soins et d'obligeance! C'est si aimable à vous et si fort sans gêne de ma part, que je ne sais comment vous dire combien je vous sais gré d'avoir pris cet embarras! Je ne croyais pas que vous seriez forcé de veiller vous-même à tout ce détail, et je vois que vous avez choisi de main de maître et surveillé cet envoi avec une complaisance tout amicale. Merci donc mille fois; mais je ne me tiens pas quitte.
J'aime bien les poules que vous expédiez; j'aime encore mieux celles que vous faites; mais j'aimerais mieux encore vous voir à Nohant mettre le nez dans notre famille, parce que je suis sûre que vous vous y trouveriez bien, et qu'une fois venu, vous y reviendriez. Vous me l'aviez promis, et je ne compte pas vous laisser tranquille que vous ne teniez parole.
Maurice vous envoie toutes ses poignées de main et remerciements; car il était comme un enfant devant l'ouverture de ce panier plein de merveilles, et tous ces grands airs de prisonniers orgueilleux qui relevaient leurs aigrettes en nous regardant de travers.
Veuillez croire à toutes mes sympathies et sentiments vrais pour vous.
GEORGE SAND.
CCCLXXXIV
A M. CHARLES-EDMOND, A PARIS
Nohant, 7 février 1855.
Je vous remercie bien cordialement, monsieur, et de l'envoi de cette relique, et des bonnes et vraies paroles que vous savez me dire. Je ne peux pas encore parler de cette douleur, elle m'étouffe toujours et j'en dirais trop!
Le plus affreux; c'est qu'on me l'a tuée, ma pauvre enfant11, tuée de toute façon. Ah! monsieur, sauvez la vôtre, ne la laissez pas sortir de l'infirmerie, et, quand elle sera guérie, ôtez-la de cette pension où la malpropreté est sordide. Les parents ne laissent pas si facilement mourir leurs enfants quand ils les ont auprès d'eux. Ils ne se fatiguent pas d'une longue convalescence à surveiller, les parents qui sont de vrais parents.
Il y en a qui sont fous et qui croient qu'un enfant est une chose qu'on peut négliger et oublier. Ma pauvre fille n'eût pas laissé mourir la sienne, et moi aussi, je suis bien sûre que je l'aurais sauvée! Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, monsieur, mais je suis bien touchée de ce que vous me dites.
Merci mille fois! je fais des voeux bien tendres et bien sincères pour votre chère petite. Ma fille vous remercie aussi.
GEORGE SAND.
CCCLXXXV
A ÉDOUARD CHARTON, A PARIS
Nohant, 14 février 1855.
Cher ami,
Je vous ai laissé souffrant. Êtes-vous mieux? Parlez-moi de vous. Il y a bien longtemps que je veux vous écrire. J'allais vous adresser une longue lettre sur le beau livre dont nous parlions ensemble. Je l'avais lu12. Mais que de chagrins m'ont frappée tout à coup! d'abord j'ai perdu deux de mes amis, et faut-il être assez malheureux pour avoir à le dire, cela n'était rien! J'ai perdu subitement cette petite-fille que j'adorais, ma Jeanne dont je vous avais parlé et dont l'absence, vous le savez, m'était si cruelle. J'allais la ravoir, le tribunal me l'avait confiée. Le père résistait par amour-propre: sans M. B…, qu'une haine sournoise, instinctive, non motivée sur des faits que je sache, mais ancienne et tenace, excitait contre moi, ce père m'eût de lui-même ramené l'enfant. Il le voulait, il l'avait voulu. L'avocat—le conseil—ne voulait pas. Ils appelaient donc du jugement, et ce jugement n'était pas exécutoire sur-le-champ. J'écrivais en vain à ce dur et froid avocat que ma pauvre petite était mal soignée, triste et comme consternée dans cette pension où il l'avait mise, lui! Et, pendant ces pourparlers, le père faisait sortir sa fille, en plein janvier, sans s'apercevoir qu'elle était en robe d'été. Le soir, il la ramène malade à la pension et s'en va chasser loin de Paris, on ne sait où. L'enfant avait la scarlatine. Elle en guérit très vite, mais le médecin de la pension juge qu'elle peut sortir de l'infirmerie. Il faut au moins quarante jours de soins extrêmes et d'atmosphère égale. On n'en a pas tenu compte. On a appelé sa mère et on a consenti à lui laisser soigner l'enfant quand on l'a vue perdue. Elle est morte dans ses bras en souriant et en parlant, étouffée par une enflure générale, sans se douter qu'elle fût malade, mais frappée de je ne sais quelle divination et disant d'un air tranquille: «Non, va, ma petite maman, je n'irai pas à Nohant, je ne sortirai pas d'ici, moi!»—Ma pauvre fille me l'a apportée, elle est à Nohant!—Elle a de la force et de la santé, Dieu merci; moi, j'ai eu du courage, je devais en avoir; mais, maintenant que tout est calmé, arrangé, et que la vie recommence avec cet enfant supprimé de ma vie…, je ne peux pas vous dire ce qui se passe en moi, et je crois qu'il vaut mieux ne pas le dire.—Ce que je veux vous dire, c'est que le livre m'a fait du bien, lui et Leibnitz. Je savais tout cela, je n'aurais pas pu le dire, je ne saurais pas l'établir, mais j'en étais sûre et j'en suis sûre. Je vois la vie future et éternelle devant moi comme une certitude, comme une lumière dans l'éclat de laquelle les objets sont insaisissables; mais la lumière y est, c'est tout ce qu'il me faut. Je sais bien que ma Jeanne n'est pas morte, je sais bien qu'elle est mieux que dans ce triste monde, où elle a été la victime des méchants et des insensés. Je sais bien que je la retrouverai et qu'elle me reconnaîtra, quand même elle ne se souviendrait pas, ni moi non plus. Elle était une partie de moi-même, et cela ne peut être changé. Mais ces beaux livres qui excitent notre soif de partir ont leur côté dangereux. On se sent partir avec eux, on s'en va sur leurs ailes, et il faudrait savoir rester tout le temps qu'on doit rester ici. J'en ai bien la volonté; le devoir est si clairement tracé, qu'il n'y a pas de révolte possible; mais je sens mon âme qui s'en va malgré moi. Elle ne se détache pas de mes autres enfants ni de mes amis. Elle voudrait suffire à sa tâche et donner encore du bonheur aux autres. Mais plus elle voit ce qu'il y a au delà de la vie de ce monde, plus elle se sépare de la volonté, qui se trouve insuffisante. Je dis l'âme, faute de savoir dire ce que c'est qui me quitte; car la volonté ne devrait pas être quelque chose en dehors de l'âme; mais la volonté ne retient pourtant pas l'âme quand l'heure est venue.
Ne répondez pas à tout cela, cher ami; si mes enfants, qui lisent quelquefois mes lettres au hasard, me savaient si ébranlée, ils s'affecteraient trop. Je veux, pour vivre avec eux le plus longtemps possible, faire tout ce qui me sera possible. J'irai avec mon fils passer le mois prochain dans le Midi pour me guérir d'un état d'étouffement qui a augmenté et qui n'a rien de sérieux cependant.
Je passerai quatre ou cinq jours à Paris au commencement de mars, pour prendre mon passeport. Je ne veux voir personne; mais vous, cependant, je voudrais bien vous voir et vous charger de dire à l'auteur de Ciel et Terre tout ce que je ne vous dis pas ici, troublée que je suis trop personnellement, et justement à cause de cette question de vie et de mort qui est là. C'est un des plus beaux livres qui soient sortis de l'esprit humain.
Il m'avait jetée dans une joie extraordinaire. Je voulais faire un volume pour le louer comme je le sens.—Je le ferai plus tard, si je peux me remettre à écrire. Mais, entre nous soit dit, je ne suis pas sûre que ce côté de la vie me revienne jamais. Je ne vis plus du tout de moi ni en moi, ma vie avait passé dans cette petite fille depuis deux ans. Elle m'a emporté tant de choses, que je ne sais pas ce qui me reste, et je n'ai pas encore le courage d'y regarder. Je ne regarde que ses poupées, ses joujoux, ses livres, son petit jardin que nous faisions ensemble, sa brouette, son petit arrosoir, son bonnet, ses petits ouvrages, ses gants, tout ce qui était resté autour de moi, l'attendant. Je regarde et je touche tout cela, hébétée, et me demandant si j'aurai mon bon sens, le jour où je comprendrai enfin qu'elle ne reviendra pas et que c'est elle qu'on vient d'enterrer sous mes yeux.
Vous voyez, je retombe toujours dans mon déchirement. Voilà pourquoi je ne peux écrire presque à personne. Il y a peu de coeurs que je ne fatiguerais pas, ou que je ne ferais pas trop souffrir. Je vous parle, à vous, parce que vous êtes comme moi à moitié dans l'autre vie, et, pour le moment, j'espère avec la bienfaisante placidité que j'avais naguère, quand je n'étais pas si fatiguée d'attendre.—Mais vous aviez le corps malade. Dites-moi donc que vous êtes mieux, avant que je quitte Nohant. Vous avez une grande ressource: c'est de pouvoir vivre à l'habitude dans le monde des idées où je vois trop en poète, c'est-à-dire avec ma sensibilité plus qu'avec mon raisonnement. Vous avez une lucidité soutenue dans ce monde-là, il me semble. C'est là qu'il faudrait pouvoir toujours regarder, sans préoccupation des soucis inévitables de la vie matérielle, des devoirs qui excèdent quelquefois nos forces, et sans ces déchirements d'entrailles que rien ne peut apaiser. C'est une loi providentielle à coup sûr que la tendresse folle des mères; mais la Providence est bien dure à l'homme, à la femme surtout. Cher ami, adieu; je suis à vous de coeur et d'esprit.
G. SAND
Бесплатно
Читать книгу: «Correspondance, 1812-1876. Tome 4»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке